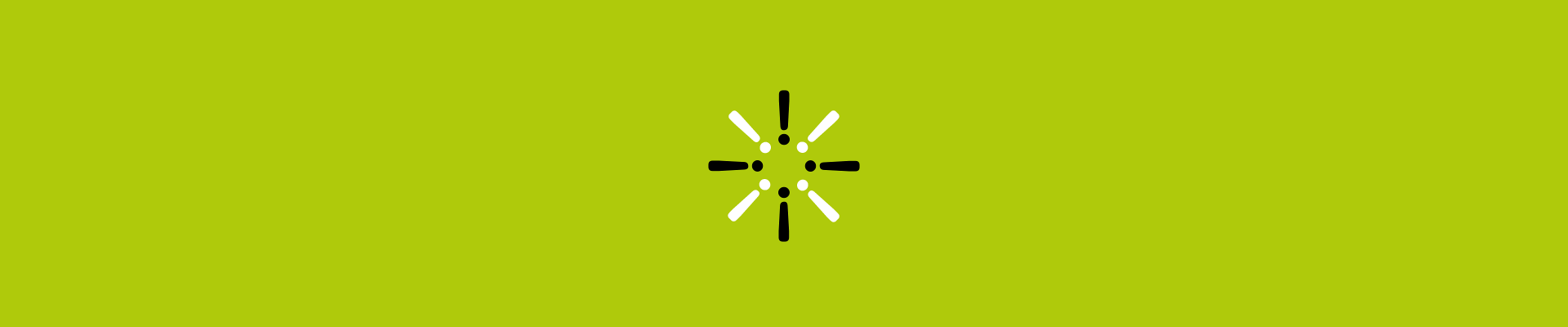Contribution de Thierry, Bonneuil-sur-marne
Jusqu’alors, je flottais vaporeux et cotonneux dans une ambiance grise et neutre qui me maintenait à distance raisonnable de mes congénères. Tout comme eux téléguidé par les consignes consuméristes, assénées en flux continu par les canaux de communication de masse, je trouvais à peine le temps d’ingurgiter diverses mixtures, « vite réchauffées-vite avalées », sans parfum ni saveur.
J’avais pourtant tenté à plusieurs reprises de m’extraire de cette gangue nauséabonde et cherché à renouer contact, à faire lien, bref à me resocialiser pour œuvrer à la régénérescence de notre pacte social. Déployant des efforts surhumains pour me décoller de mon canapé « LouBovin », je commençais par limiter à quatre heures quotidienne ma consommation d’écrans en tout genre. L’essentiel était d’éviter une crétinisation accélérée de mon cerveau. Cette mise en mouvement douloureuse nécessita l’aide d’adjuvants de confort, absorbés désormais à doses non homéopathiques.
Gavé de tout, lassé de rien, je m’étais donc résigné à sortir de ma torpeur. Il était temps pour moi de m’engager dans une humaniste épopée devant me réconcilier avec mes semblables égarés dans cette surabondance destructrice. Tel un zélé fidèle récemment converti à une nouvelle croyance, je zigzaguais avec application entre les églises sacrificielles de l’épanouissement personnel. Toutes disposées à satisfaire l’apprenti du bien-être collectif que je m’apprêtais à devenir, elles constituaient un paravent idéal aux grandes passions déclinantes dans lesquelles mes aïeuls s’étaient perdus dans le siècle précédent. Identité remarquable, agent d’innovation et être singulier, je ne pouvais me résoudre à adorer les icônes d’antan. J’avançais, telle Osiris remontant le Nil, dans ma barque de renaissance, armé d’une détermination brumeuse mais suffisamment oppressante pour déplacer cette satanée croix de vie qui m’accompagnait depuis une trentaine d’années.
La bonne conscience de mon environnement professionnel, où œuvraient en permanence les prêtres du bien-être au travail et du management renouvelé, avait eu raison de mon immobile neutralité. Fatigué de subir une logorrhée « managério-boudino-confuse », servie avec condescendance à mes compatriotes de la précarisation, je me décidai à prendre le flambeau de la rébellion active. Convaincu que mon combat ne pouvait être gagné qu’en infiltrant les forces adverses, je me concoctai alors un programme de marathonien du développement personnel. Engloutissant méthodes, ouvrages et formations, je poursuivis mon pèlerinage boulimique par un trimestre immersif devant révéler mon moi intérieur à même de faire groupe avec les autres.
Parce qu’il me semblait logique d’en revenir aux origines, j’entamai mon initiation par un long week-end « Cro-Magnon » dans le Gers avec quelques peaux de bêtes égarées tout comme moi dans ce monde « numérico-contemporain ». Il est vrai qu’en matière de « low-tech », j’eus mon lot de satisfaction. Rentré gelé et égratigné de partout, la compagnie de sarcoptes qui me raccompagna jusqu’à mon chez-moi anima mes nuits pendant plus d’une semaine. Sorti de cette « gale-ère » de démangeaisons, je m’engageai avec enthousiasme dans le festival des Premières Nations amérindiennes dans les Cévennes où la faune urbaine trouvait habituellement refuge. Je pus durant près de 72 heures danser au son des tambours et vivre à plein la cérémonie du Pow-Wow. Afin de reposer mes pieds et jambes endoloris, j’enchaînai par une semaine de sylvothérapie dans les Vosges. Embrasser des arbres pendant des jours et des nuits me familiarisa avec la faune de l’écorce qui prit en affection ma chevelure et ma barbe. Urbain depuis trop longtemps, je ressentis ensuite le besoin de me plonger à nouveau dans cet océan de béton qui constituait mon quotidien depuis l’amorce de mes études supérieures. Transition idéale après mon séjour champêtre et forestier, la « noctanbalade urbaine inversée » ou, pour le dire sans façon, la visite à la frontale des catacombes et souterrains en tout genre me semblait idéale. Celle-ci était sensée me faire retrouver les forces englouties et cachées à partir desquelles il me serait envisageable de me fondre dans le collectif et de faire société. Enfin, souhaitant me relier avec ma génération d’êtres mobiles et connectés en lutte contre la suprématie des marques, je me convainquis qu’un rallye-roller dans la tenue d’Adam et Eve finirait de me laver des oripeaux de ce monde dépravé, vendu au pétro-capitalisme.
Au sortir de ces expériences, je ne retins in fine que la sensation d’une somme de solitudes égocentriques, d’une foule d’individus tout aussi perdus que moi-même. Tous en quête d’un je-ne-sais-quoi permettant de s’apprécier et de se relier aux autres, nous errions tels des zombies dans un environnement sans aspérités, lisse et inodore. Nous avions tous besoin de ces shoots tribaux, de ces translations spatio-temporelles, acceptables parce que de courte durée. Le seul intérêt notable de ces épreuves fut pour moi l’ouverture progressive de mon coffre-fort d’odeurs ensevelies au fond de mon hippocampe. Terre humide, salpêtre caverneux, écorce sèche, sueur sportive, viande grillée, boissons fermentées…, j’associais progressivement des images issues de mon histoire personnelle à ces exhalaisons enfouies.
J’en étais là de ma démarche de reconstruction sociale quand je me vis répondre enfin au quarantième appel téléphonique successif de ma sœur. Cette insistance intrigante combinée à mon amorce d’introspection odorante eut raison de cette règle de l’échange épistolaire annuel du nouvel an.
C’est ainsi que tout a basculé. Exfiltré brutalement de mon univers d’indifférence, tout ce monde enfoui, que je redécouvrais progressivement depuis peu, m’explosa alors au visage. Une avalanche d’odeurs, de sensations, d’images s’abattit sur moi : galettes de sarrasin, eau de cologne de lavande, roses du jardin, beurre poêlé, châtaignes grillées, encaustique chauffé, vapeurs d’alambic, fourrage fermenté, vin chaud, émanations de stabulation, pailler d’été, haies d’ajoncs et de genêts… Toute cette savoureuse ivresse aromatique me renvoyait à ma grand-mère désormais disparue et à ce temps bienheureux où seul l’amour de mes proches me suffisait.
Bercé par les cantiques et plus particulièrement par « l’Itron santez anna », enveloppé des effluves d’encens, d’œillets, de chrysanthèmes, de bougies et de buis du cimetière, c’est toute une farandole de vibrations et d’odeurs qui me guida, au terme de cette cérémonie d’adieux, au bistrot du centre, le bien-nommé « Gwin ar Ch’alloued », le vin des français. Tout le village de mon enfance s’y retrouva afin de célébrer une dernière fois l’être cher disparu. Entre apéritifs et embrassades, rires et chants, je retrouvai ainsi toute la fraternité et la simplicité de cet univers d’antan où chacun se préoccupait tout autant de lui que du groupe. Tel Astérix se réconciliant avec ses amis belges autour d’un banquet, j’incarnais successivement tous les personnages de la traditionnelle ripaille de dernière page de ma bande dessinée d’enfant.
En dépit de sa profonde tristesse, cette communion collective agrémentée de nourritures et boissons en tout genre me rechargea comme jamais. Elle devint dès lors mon guide et ma boussole dès mon retour à l’Est, en zone artificialisée et dense. Faisant fi des tracas du quotidien, des perpétuelles injonctions contradictoires de mon environnement professionnel et d’incompréhensibles réformes de consécutifs gouvernements en perdition, je conservais le rythme de réguliers et traditionnels festins collectifs auxquels amis, voisins, récents collègues étaient joyeusement conviés pour faire société et changer le monde. Nous festoyions, nous buvions et nous mangions, bref nous étions ensemble et moi je m’enivrais de vins, de mets mais aussi et surtout de la richesse des autres. Là était bien l’essentiel.